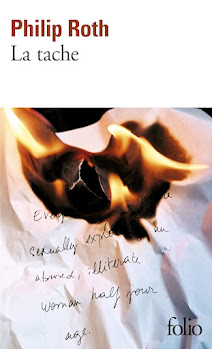Un jour, une étrange
queue se manifeste dans la baie de Tokyo. Quelques heures plus tard, une
créature surgit de la mer et terrorise des quartiers. Une attaque avec
hélicoptères contre l'organisme en pleine mutation est organisée, puis annulée
; le monstre en profite pour fuir vers la mer. Lorsque l'animal titanesque
refait son apparition sous une toute nouvelle apparence, sa volonté est de
détruire le Japon. Le gouvernement japonais va devoir tout tenter pour éliminer
la bête géante, surnommée Godzilla.
Devenu avec le temps un emblème de la pop culture japonaise,
Godzilla est à l’origine une illustration du traumatisme nucléaire japonais
avec cette créature toute puissante et destructrice. Le Godzilla de Ishiro Honda (1955) sorti quelques années à peine après
les bombardements d’Hiroshima et Nagasaki était ainsi un film oppressant
ravivant sous un angle spectaculaire et mythologique des blessures encore
vivaces. Au fil des multiples suites et de la popularité du genre kaiju-eiga, le bestiaire s’est enrichi
(le ptérodactyle Rodan, le papillon Mothra, la tortue Gamera) et le passif
inquiétant initial s’est parfois dilué dans le divertissement bariolé. Lorsque Shin Godzilla sort en 2016, près de
douze ans se sont écoulé depuis le précédent opus de la franchise (si l’on fait
exception du remake américain de 2014 signé Gareth Edwards), le plutôt déjanté Godzilla: Final Wars de Ryuhei Kitamura.
Un monde en somme puisqu’entre temps la catastrophe nucléaire de Fukushima de
2011 a ravivée toutes les peurs désormais lointaines pour la jeune génération. Shin Godzilla en tient bien évidemment
compte et revient de manière passionnante à l’essence sombre de mythe.
Au commande on trouve le très cérébral Hideaki Anno qui
malgré quelques excursion live (l’adaptation kitsch du manga Cutey Honey de Go Nagai, l'adaptation de Ryu Murakami Love and Pop (1998)) est surtout
connu pour son travail dans l’animation, étant le fondateur du mythique Studio
Gainax et le créateur de séries cultes telles que Neon
Genesis Evangelion ou Nadia, le
secret de l’eau bleue. On peut donc largement lui attribuer à dimension
réflexive du film tandis qu’à la coréalisation il est accompagné de Shinji
Higuchi (ayant également débuté dans l’animation) habitué des effets spéciaux
et de ce types de logistiques après avoir adapté en live le manga et la série d’animation
L’Attaque des titans (2015). L’une
des premières surprises de Shin Godzilla est d’être l’anti-film catastrophe dans
sa narration et construction. Les apparitions furtives puis spectaculairement
concrètes de Godzilla alternent ainsi avec des scènes de bureau où les membres
du gouvernement japonais débattent sur la marche suivre. Il est impossible de ne pas voir dans
cette vision une critique des atermoiements réels des dirigeants japonais après
le tsunami et l’incident nucléaire de Fukushima.
En effet le système pyramidal
japonais joue à plein ici dans le montage où différents cabinets et ministères
se renvoient la balle sans réellement savoir quoi faire. Ces dirigeants
hésitants sont cependant omnipotents du fait de leur seule ancienneté quand le
jeune assistant (Hiroki Hasegawa) évoquant le premier la possibilité d’une
créature est moqué jusqu’à l’apparition effective de Godzilla aux yeux de tous.
On sent qu’Anno (qui a dû surmonter cette organisation figée en fondant son
propre studio) fustige un Japon sclérosé, où chacun se décharge et renvoie la
décision plus haut où trône pourtant un Premier Ministre tout aussi indécis.
Certaines scènes s’avèrent explicites à ce titre lorsque des experts biologistes
installés seront sans réponses quand une jeune femme moins « gradée »
saura donner des éléments plus concrets.
Les cadres fixes, les discours convenus, les postures
statiques et les couleurs monochromes de ces séquences de bureau constituent un
contrepoint à la menace de Godzilla. Les humains et plus spécifiquement les
japonais engoncés dans leurs traditions ne peuvent lutter farce à la forme
mouvante de la créature. La première manifestation de Godzilla nous en montre
un design assez éloigné de ce que l’on en connaît, rampante, perdue et avançant
sans but. L’évolution est cependant au cœur de sa nature, l’être aquatique
parvenant à marcher, se redresser et devenir peu à peu le croisement de
mammifère et reptile menaçant inscrit dans l’inconscient collectif. Quand les
humains n’ont qu’une violence basique à lui opposer, les aptitudes de Godzilla
se révèlent à travers son métabolisme mutagène lors de séquences
spectaculaires. Une stupéfiante scène d’apocalypse nocturne déploie toute l’emphase
cauchemardesque dont est capable Anno et fait également office de catharsis qui
« efface » l’ancienne génération. La fascination pour la destruction
qui court dans l’œuvre d’Anno trouve toujours son écho dans le tourment
intérieur de ses personnages devant y répondre (particulièrement dans
Evangelion), et ici symbolisé plus globalement par le Japon moderne.
Le scénario pousse le vice jusqu’à solutionner une nouvelle
fois ce problème japonais par une frappe nucléaire sur Tokyo destinée à
annihiler Godzilla. La dernière partie du film tend ainsi à une union, à un
réveil des forces vives ainsi qu’à l’avènement de jeunes gens qui sauront faire
différemment pour répondre au danger. C’est le mimétisme d’un Japon passé ayant
plus d’une fois affronté le chaos et la destruction (le séisme du Kanto en
1923, ceux de Kobé en 1995) et qui par son union, son ingéniosité technologique,
a toujours sut s’en relever. Après avoir montré les travers qui l’ont parfois
perdu, Anno orchestre donc un climax à la fois tendu et ludique pour affirmer
le renouveau possible du Japon. Godzilla déchaînait sa furie dans les ténèbres
de l’ancien monde, il stoppera sa marche dans la lumière du nouveau.
Ce
renouveau passe d’ailleurs par une ouverture, une hybridation contenue dans les
passages où l’on voit le reste du monde aider le Japon, mais aussi par le
personnage métissé joué par Satomi Ishihara (représentant tour à tour l’arrogance
étrangère et le respect de sa terre natale). Cette hybridation a d’ailleurs
cours dans les techniques du film, mélangeant habilement la tradition du
cascadeur en costume et des effets numériques très réussis (pas une gageure
dans des productions japonaises pas toujours loties à ce niveau). Shin Godzilla est une œuvre passionnante
et habile entre imagerie feutrée et spectaculaire pour affirmer son propos.
Sorti en bluray et dvd zone 2 anglais doté de sous-titres anglais chez Manga