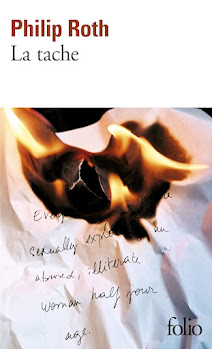Il s’agit ici de l'histoire vraie de Maître Yu qui créa sa propre école de l'Opéra de Pékin à Hong-Kong. Ses élèves n’étaient autres que Jackie Chan, Sammo Hung, Yuen Biao et Corey Yuen. Sammo incarne ce « sifu » très strict où son entraînement implacable fera d’eux des artistes martiaux complets.
Painted Faces est une belle évocation de la Peking Opera School, école perpétuant à Hong Kong la tradition de l’Opéra de Pékin et dont furent issus quelques célébrités futures du cinéma local comme Jackie Chan, Sammo Hung, Yuen Biao ou Corey Yuen. L’histoire suit depuis l’enfance les protagonistes y faire leur apprentissage sur la férule de Maître Yu, dont l’entraînement impitoyable va progressivement les endurcir et en faire les artistes qu’on connaît. Le film est autant un biopic choral qu’un portrait en creux de ce « sifu » certes rigide, mais vraiment aimant et véritable parent de substitution pour ses élèves. Ces derniers, souvent issus de familles pauvres n’ayant pas les moyens de les élever trouve donc là malgré la discipline rugueuse, un véritable foyer et des « frères » avec lesquels les liens se maintiendront toutes leur vie – notamment le rapport d’autorité au « Grand frère » avéré entre Sammo Hung et Jackie Chan.
La première partie durant l’enfance alterne entre séquences d’apprentissage douloureuse, mise en pratique scénique dans les divers lieux de spectacle de la ville, et moments plus légers où les élèves peuvent demeurer malgré tout des enfants à travers d’amusantes facéties. On ressent vraiment l’investissement artistique, social et intime de Maître Yu par l’interprétation pleine d’authenticité de Sammo Hung. Il incarne ici son propre maître (sans pour autant lui ressembler physiquement) et dégage une autorité naturelle (qu’il reproduira sur les plateaux de tournage où il sera chorégraphe, cascadeur, réalisateur), un charisme mais aussi une sympathie issue de son passif comique auprès du grand public qui humanise grandement le personnage malgré sa sévérité. Une des plus belles scènes est lorsqu’il défendra ses élèves (en l’absence de ceux-ci) devant un voisin méprisant leur basse extraction sociale, croyant en leur avenir justement grâce à ce parcours difficile plutôt qu’un nanti sans hargne en ayant tout obtenu aisément. Painted Faces montre aussi une Hong Kong à la mentalité changeante, s’occidentalisant et délaissant désormais son héritage culturel traditionnel. La seconde partie sur l’adolescence nous dépeint le déclin des spectacles de l’Opéra de Pékin, joués devant des salles vides et un public de plus en plus âgé. Les divertissements marquent l’influence de l’Occident à travers l’arrivée du rock, l’évolution de la mode vestimentaire et le monde du cinéma désormais le seul lieu où les élèves pourront exploiter leurs capacités. Maître Yu sent venir se déclin et s’inquiète pour ses ouailles, elles-mêmes décalées quand elles veulent se mêler aux amusements modernes des adolescents de leur âge. L’émotion fonctionne vraiment par un vrai sens du mélo tendre d’Alex Law, de l’interprétation attachante des jeunes acteurs et une belle bande-originale de Lowell Lo. Ce thème du déracinement social, culturel, est au cœur des autres œuvres d’Alex Law et de sa compagne Mabel Cheung au scénario (Painted Faces étant une exception puisque les rôles sont généralement inversés). Ils parviennent ici à le mêler à cette tonalité de biopic et de récit d’apprentissage, tout en amenant une intéressante dimension référentielle à l’ensemble. Le film est en effet une coproduction entre la Shaw Brothers et Golden Harvest, studios longtemps rivaux avant que Golden Harvest (dont le fondateur Raymond Chow fut producteur à la Shaw Brothers avant de se lancer seul) prenne le dessus commercialement dans les années 80. La présence de Cheng Pei-pei au casting, le tournage de certaines séquences dans les mythiques studios Shaw Brothers et les nombreuses allusions à des œuvres fameuses tournées là dans les dialogues entretiennent cet aspect. Painted Faces est donc un beau film montrant une page se tourner (magnifique scène d’adieu final au « sifu ») mais qui, par la connaissance que nous avons du destin de chacun, promet un avenir doré pour lequel ces efforts n’auront pas été vains.
Sorti en bluray et dvd zone 2 français chez Spectrum Films