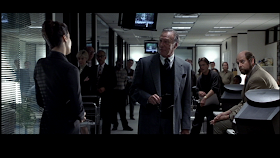Claude Autant-Lara réalise un des films les plus scandaleux de l'après-guerre avec cette adaptation du roman éponyme de Raymond Radiguet, provoquant un tollé équivalent à celui de l'ouvrage lors de sa parution en 1923. Le film comme le livre paraissent à deux moments clés de la société française ce qui explique leur impact. Le tout jeune Raymond Radiguet, s'inspirant de l'aventure qu'il eut à 14 ans avec sa voisine dont le mari était mobilisé rédigea ainsi Le Diable au corps dans un style rageur et direct que sa mort prématurée entourera d'un certain mythe de la jeunesse. Le scandale naîtra bien sûr de la relation adultère du récit mais aussi du contexte où cette faute apparait comme non seulement immorale mais antipatriotique et irrespectueuse envers les poilus ayant abandonnés le foyer pour défendre la nation.
C'est face à un même état d'esprit que se confrontera Autant-Lara avec son adaptation tournée en 1946 et qui ne doit son existence qu'à l'accord entre Micheline Presle (la grande star française de l'époque depuis le départ aux Etats-Unis de Michelle Morgan et la carrière momentanément interrompue de Danielle Darrieux) et le producteur Paul Graetz qui lui laissait libre choix dans ses projets futurs ainsi que de ses réalisateurs et partenaires. C'est donc elle qui ira chercher Claude Autant-Lara, précisément le plus à même de respecter la nature sulfureuse du roman et elle aussi qui insistera pour le choix de Gérard Philippe (qui refusera d'abord car s'estimant trop vieux avant de revoir sa position, défié par Autant-Lara) en héros adolescent après avoir été épatée par une de ses performances au théâtre.
Dans ce cadre d'après-guerre le film représente autant une provocation pour les adultes qu'une illustration de la soif de liberté de la jeunesse d'alors. Une jeunesse en partie volée par les années d'Occupation et prête à se déchaîner et profiter de cette liberté retrouvée, faisant des héros du film leur symbole. François (Gérard Philippe) est un lycéen de 17 ans qui va s'éprendre de Marthe (Micheline Presle) une jeune aide-soignante dans l'hôpital militaire avoisinant son école. Les deux personnages représentent une population traitée comme quantité négligeable et dont on ne soucis guère alors des états d'âmes, la jeunesse et les femmes. Dès la première rencontre Marthe étroitement surveillée par sa mère ne semble ainsi guère avoir plus d'autonomie que l'encore mineur François. La fougue de ce dernier l'émeut pourtant et leurs échanges entre tendresse et dispute, déclarations enflammées et doute constant sur les sentiments de l'autre seront toujours passionnés et conflictuels.
Le désir ardent de François s'exprime ainsi par sa nature impulsive quand Marthe plus réfléchie procède à un abandon plus subtil, plus beau et douloureux à se manifester. Ces natures opposées amèneront alors une première rupture qui annonce la seconde plus dramatique et toujours due à l'immaturité de François. Gérard Philippe est parfait en homme enfant irrésolu découvrant l'ivresse des sens et dont l'amour s'exprimera toujours de la mauvaise façon. Les scènes de tendresse avec Marthe relève toujours par leurs dispositions d'une dimension maternelle où François fait souvent office d'enfant geignard et capricieux réclamant des preuves d'affection. Le héros de guerre, l'homme, le vrai est toujours pour Marthe son époux mobilisé et malheureusement pour elle celui qu'elle aime n'est encore qu'un adolescent peu sûr de lui sous ses airs bravache – soulignée par cette réplique lourde sens vers la fin « Pourquoi n’es-tu un homme que quand tu me tiens dans tes bras ? » -.
Le manque de courage de François s'illustrera cruellement lors de divers moment clés où il se dérobera alors qu'il doit prendre ses responsabilités. Ce sera ces sueurs froides quand il pense avoir affaire à l'époux trompé, le final dans le café où il ne sait que faire et un soldat/adulte prendra les choses en main pour Marthe malade et bien sûr l’instant charnière où sur un caprice il ne rejoindra pas Marthe sur le quai où elle l'attend à la tombée de la nuit. Autant-Lara (accompagné de Jean Aurenche et Pierre Bost au scénario et dialogue) n'accable pourtant pas son héros, c'est cette société oppressante qui demande aussi sans doute trop et trop vite à cette jeunesse ayant osé défier l'autorité. François se perdra à ne pas assumer jusqu'au bout sa rébellion et Marthe au contraire par son refus d'entrer dans le rang, l'incapacité à quitter son aimé dans le final pouvant presque être vu comme une sorte de suicide.
Derrière cette facette dramatique, Autant-Lara ose le vertige des sens le plus prononcé pour exprimer cette passion inconditionnelle. On pense bien sûr à cette magnifique scène au crescendo érotique irrépressible où Marthe frictionne François dans son lit. La censure ne permettant pas de montrer l'étreinte attendue, un travelling traversera l'arrière du lit, laissant leur corps à l'état d'ombre tamisées enlacées pour s'arrêter sur un feu de cheminée se ranimant soudain pour signifier la consommation de leur amour. A chaque fois pourtant le jugement moral et les regards inquisiteurs viendront atténuer la portée de leur bonheur, que ce soit l'arrivée de la mère au matin après leur première nuit, les voisins malveillants les observant durant la ballade en barque. Tout cela semble être voué à être éphémère, l'ironie voulant que leur romance s'épanouisse une fois Marthe mariée et donc plus libre d'aller et venir.
L'aspect fondamental de ce contrepoint est le rapport à la guerre. Le monde étant en pause à cause du conflit permet au couple de se rapprocher et l'armistice signifiera un retour à la normale et à la prison des conventions. On est marqué par cette Marseillaise sonnant comme une marche funèbre dans la scène du café, le visage défait de Marthe et François s'opposant à la liesse les entourant. Un effet encore renforcé par la terrible scène finale où un François brisé observe les célébrations de la paix, symbole du triomphe du collectif sur les destins individuels.
Le film remportera un succès à l'échelle de son scandale et sera fustigé par l'opinion bien-pensante y voyant l'exaltation de l'adultère et l'ode à l'antimilitarisme. L'un des faits marquant sera notamment le départ de l'ambassadeur de France en cours de projection durant le festival de Bruxelles où Gérard Philippe recevra le prix d'interprétation masculine (qui lancera sa grande carrière de jeune premier). Un des grands films d’Autant-Lara, toujours aussi inspiré pour bousculer les conventions de l’époque.
Sorti en dvd zone 2 français chez Paramount