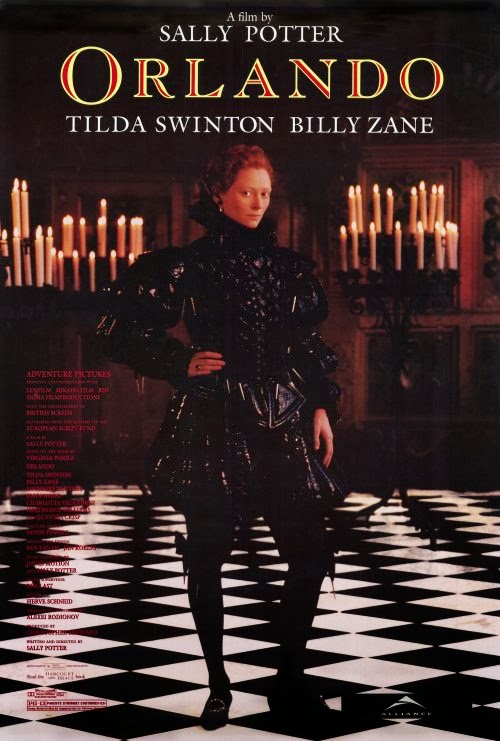Inspiré par le fameux concepteur d’avions Giovanni Caproni, Jiro
rêve de voler et de dessiner de magnifiques avions. Mais sa mauvaise vue
l’empêche de devenir pilote, et il se fait engager dans le département
aéronautique d’une importante entreprise d’ingénierie en 1927. Son génie
l’impose rapidement comme l’un des plus grands ingénieurs du monde. Le Vent se lève
raconte une grande partie de sa vie et dépeint les événements
historiques clés qui ont profondément influencé le cours de son
existence, dont le séisme de Kanto en 1923, la Grande Dépression,
l’épidémie de tuberculose et l’entrée en guerre du Japon. Jiro connaîtra
l’amour avec Nahoko et l’amitié avec son collègue Honjo. Inventeur
extraordinaire, il fera entrer l’aviation dans une ère nouvelle.
Hayao Miyazaki avait déjà sérieusement tiré sa révérence en 1997 au moment de la sortie de
Princesse Mononoké,
mettant tout dans cette œuvre testament : le souffle épique, les
questionnements écologiques et une aura romanesque flamboyante tout en
dressant un constat lucide et désabusé sur la séparation inéluctable
entre le mythe/la tradition et la modernité où les grandes légendes
d’antan ne pouvaient plus qu’être des symboles diffus dans le monde
contemporain. Un monde où il n’avait plus sa place puisqu’il s’apprêtait
à se retirer ; mais la mort de Yoshifumi Kondo, son successeur désigné à
Ghibli (et auteur du merveilleux
Si tu tends l’oreille 1995) l’obligea à revenir. Un retour en forme de second souffle pour Miyazaki durant les années 2000 qui bien après
Mon Voisin Totoro (1988) renouerait avec le point de vue d’une fillette pour son Alice japonais (
Le Voyage de Chihiro (2002)), retrouverait les atmosphères épiques et les influences occidentales des débuts dans une tonalité différente (
Le Château ambulant (2004)) et signerait son œuvre la plus euphorisante avec l’enchanteur
Ponyo sur la falaise (2008).
Tout comme la mélancolie des années 90 avait répondu à la fougue de la
décennie précédente, Miyazaki signe une œuvre particulièrement mortifère
avec
Le Vent se lève, comme pour nous rappeler un âge
avancé qu’on avait fini par oublier avec la fontaine de jouvence que
constituait sa filmographie des années 2000.
Le Vent se lève est un film somme où Miyazaki semble avoir réuni toutes ses préoccupations. Si
Princesse Mononoké était le constat de sa vision du monde,
Le Vent se lève,
lui, fait un bilan beaucoup plus intime de l’état d’esprit de l’auteur.
A l’origine un projet personnel destiné à être publié en manga,
Le Vent se lève
devient un film grâce au producteur (et cofondateur de Ghibli) Toshio
Suzuki qui aura convaincu le maître d’en faire la prochaine production
Ghibli. Pour Miyazaki le cinéma doit avant tout être un divertissement,
une évasion où peuvent s’insérer des thèmes plus profonds (il reprocha
ainsi à l’époque à son ami Isao Takaha la noirceur de son
Tombeau des Lucioles alors que lui-même signait
Mon Voisin Totoro).
Pourtant là l’auteur s’éloigne de ce précepte avec un biopic romancé de
Jiro Horikoshi, ingénieur créateur du révolutionnaire avion Zero qui
fit des ravages durant la Deuxième Guerre mondiale sur le front du
Pacifique. On retrouve ainsi la fascination des airs de Miyazaki avec ce
personnage se rêvant pilote mais qu’une mauvaise vue va inciter à
devenir ingénieur pour rester au plus près de sa passion. Sur une
période de quinze ans, on assiste ainsi à une sorte d
’Etoffe des héros
japonais où les recherches et atermoiements de Jiro amenant à la
fabrication du Zero se mêlent à l’Histoire du pays en train de basculer
dans l’horreur belliqueuse et totalitaire.
L’intrigue est en de nombreux points autobiographique pour Miyazaki, où
Jiro est son double. Comme précédemment évoqué,
sa propre passion pour l’aviation est née durant l’enfance grâce à son
père directeur de l'entreprise aéronautique familiale participant
justement à la chaîne de fabrication des Zero. La fascination pour les
engins ailés se conjugue ainsi à l’aura de mort qu’ils dégagent par
l’usage qui en sera fait, thème récurrent chez l’auteur.
Le Vent se lève
exprimera donc dans un premier temps la fougue de cet attrait des airs,
que ce soit par les clins d’œil de Miyazaki à sa filmographie (la scène
de rêve d’ouverture semblant échappée du
Château dans le ciel),
la manière amusée d’exprimer l’influence européenne chez son héros (les
apparitions rêvées du mentor et précurseur italien Gianni Caproni) et
bien sûr le bouillonnement d’activité des bureaux de l’usine qui renvoie
évidemment à ceux agitant le Studio Ghibli dans un mimétisme évident. Peu à peu pourtant un voile vient assombrir cette vision. Le sentiment
d’insécurité s’exprimera d’abord par une terrible séquence illustrant le
séisme de Kanto en 1923 et où l’on sent la nature prête à se révolter
face à la folie des hommes. Même s’il n’en fait pas le cœur du récit, le
poids du régime totalitaire japonais traverse tout le film, tout comme
ce double regard si cher à Miyazaki durant le voyage de Jiro en Europe
où il se confronte à la haine des nazis tout en s’ouvrant à de nouveaux
horizons avec le savoir-faire technologique et la culture occidentale.

Le plus grand pas en arrière, Miyazaki le fait pourtant avec l’attitude
de son personnage principal. Obsédé qu’il est par sa tâche, Jiro a à
peine le temps de se consacrer à sa fiancée Nahoko. Le scénario dessine
tous les contours d’une romance flamboyante mais qui ne le sera jamais
complètement. La première rencontre en plein durant le chaos du séisme,
la seconde le temps d’un été de vacances et les charmantes séquences qui
en découlent (Jiro rattrapant l’ombrelle de Nahoko emportée par le
vent, tous deux s’amusant d’un avion de papier alors que Nahoko est
convalescente) humanisent d’ailleurs grandement un Jiro jusqu’ici trop
hermétique (et doublé de la voix terne de cet autre grand de la
japanimation qu’est Hideaki Anno, sollicité par son ami Miyazaki dans
cette tâche inhabituelle pour lui).
Là encore des éléments personnels
viennent se greffer. Nahoko est atteint de tuberculose tout comme la
propre mère de Miyazaki à l’époque, un élément qu’il avait déjà intégré
dans
Mon voisin Totoro où la mère des deux fillettes
était absente car au sanatorium. La pudeur de l’auteur avait laissé cet
élément flou, au point de faire des héroïnes des sœurs pour éviter tout
mimétisme avec lui alors que le scénario initial en faisait des frères.
Cette fois Miyazaki exprime pleinement cette culpabilité avec une
romance feutrée, résignée et condamnée, qui est paradoxalement la plus
charnelle de sa filmographie très chaste mais finalement la moins
poignante.
Le contexte historique semble comme écraser les personnages,
Nahoko étant une figure sacrificielle et effacée dévouée à son époux,
Jiro en dépit de son amour sincère ne s’écartant pourtant jamais de sa
mission. Le drame s’exprime ainsi dans une retenue touchante (la belle
scène de mariage) mais où l’on sent Miyazaki peu à l’aise.
Le constat
final amer de
Princesse Mononoké n’empêchait
pas une vraie portée romanesque quand, dénué de ses démons et
merveilles, Miyazaki semble paradoxalement comme cloué au sol pour
laisser respirer ce qui est son œuvre la plus personnelle, l’austérité
des personnages jurant avec la vaillance farouche de ses héros
habituels. Cette fois tout semble joué et il n’y a plus de raison d’y
croire alors que le monde pouvait sombrer sans que l’on cesse d’essayer
de se relever, encore et toujours (
Nausicaä,
Le Château dans le Ciel,
Princesse Mononoké,
Le Voyage de Chihiro...).
A nouveau, c’est sans doute dans le parcours de Miyazaki qu’il faut
chercher cette carence. L’impact de la guerre et les conséquences du
grand œuvre de Jiro ne s’illustreront qu’en toute fin dans une scène
onirique renvoyant notre héros à une culpabilité nationale et
personnelle par la perte de sa fiancée malade. Un culpabilité que
partage sans doute aussi le réalisateur, entièrement dévoué à ce Studio
Ghibli qui lui a au moins coûté des relations difficiles avec son fils
Goro dont il s’opposa au passage à la réalisation avec
Les Contes de Terremer et auquel il mena la vie dure sur le tournage de
La Colline aux coquelicots
(2012) qui avec moins de lourdeur évoquait des thèmes voisins.
Toute
cette longue quête semble ainsi avoir été vaine pour Jiro dont la
silhouette disparait lentement à l’horizon en conclusion. Miyazaki
pense-t-il aussi la même chose en se retirant sur une œuvre si résignée
ou adhère-t-il au leitmotiv du poème de Paul Valery donnant son titre au
film : «
Le vent se lève, il faut tenter de vivre » ? La réponse est sans doute entre les deux, et suspendue à une possible volte-face du sensei.
En salle en ce moment

.jpg)