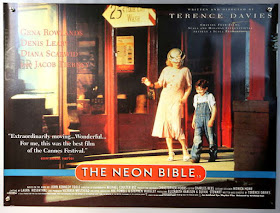Dans les années 40, la vie de David, originaire
d'une petite ville fondamentaliste de la région du sud des Etats-Unis,
est bouleversée par l'arrivée de sa tante Mae. Ancienne chanteuse de
cabaret, Mae vient s'installer dans la maison qu'habitent David et ses
parents et devient rapidement sa seule amie.
The Neon Bible est la première œuvre de Terence Davies qui le sort de la veine autobiographique qui caractérisait ses premiers films, The Terence Davies Trilogy (1984), Distant Voices, Still Lives (1988) et The Long Day Closes (1991). L'autre versant de la filmographie de Davies réside en effet dans la grande adaptation littéraire avec Chez les heureux du monde (2001) d'après Edith Wharton, The Deep Blue Sea (2011) d'après Terrence Rattigan ou encore Sunset Song (2015) d'après Lewis Grassic Gibbon. The Neon Bible est donc la transposition du roman éponyme de John Kennedy Toole (surtout connu pour La Conjuration des imbéciles), le premier de son auteur mais paru à titre posthume en 1989, 20 ans après sa mort.
Le
récit nous plonge dans le sud des Etats-Unis dans les années 40 et
accompagne le difficile quotidien du jeune David (Jacob Tierney). Le
contexte est difficile à la fois dans le cadre intime avec une mère à
l'équilibre mental fragile et un père violent et abusif, tandis que la
ville est plongée par une forme de fondamentalisme religieux exacerbé.
Le seul rayon de soleil est la présence chaleureuse de sa tante Mae
(Gena Rowlands), ancienne chanteuse de cabaret au tempérament fantasque.
Terence Davies ne révolutionne pas particulièrement son approche malgré
cette source différente. Le récit n'est pas aussi kaléidoscopique que Distant Voices, Still Lives et The Long Day Closes
car suivant une vraie évolution temporelle (à travers David que l'on
voit grandir, mais aussi du contexte historique notamment le marqueur de
la Deuxième Guerre Mondiale) mais l'idée reste la même en nous faisant
sauter d'une tranche de vie à une autre, heureuse ou tragique. Terence
Davies conserve également sa veine nostalgique à travers quelques
vignettes qui fonctionnent mieux sur les purs éléments intimistes que
dans ceux culturels (même si l'on retrouve son gout du music-hall et du théâtre dans quelques séquences et bien sûr le personnage de Gena Rowlands) où son rapport personnel à l'époque et à
l'Angleterre rendaient l'émotion plus palpable et authentique sur les
précédents films.
Terence Davies ne s'approprie vraiment le film
que par ses choix formels où il sort de sa zone de confort. Le héros
David n'a jamais quitté sa vallée et Davies traduit à la fois cet
enfermement dans un cadre, une mentalité, mais aussi le désir de s'en
échapper. Le réalisateur multiplie les cadres dans le cadre signifiant
autant une prison qu'une vue sur l'ailleurs avec ses fenêtre donnant sur
des nuits étoilées, ses portes vitrées donnant sur un jardin, une
ruelle. Les nombreux fondus au noir sont tour à tour diégétiques et
extra diégétiques, traduisant eux constamment un sentiment d'étouffement
et plus particulièrement celui de fondamentalisme religieux. Davies
capture notamment très bien une forme d'obscurantisme avec le
contraste d'une référence culturelle et de l'imagerie religieuse, que ce
soit un standard musical accompagnant une scène où des livres
"scandaleux" sont brûlés ou le célèbre thème musical d'Autant en emporte le vent
introduisant les vociférations d'un prêcheur hystérique à la Elmer
Gantry.
Ce contexte américain qu'il ne parvient pas toujours à traduire
par la narration, Davies l'exprime donc subtilement dans sa mise en
scène. Cela passe aussi comme souvent avec lui par l'inspiration
picturale, les chaleureux instants partagés entre David et sa tante Mae
nous plongeant dans des atmosphères où des tableaux d'Edward Hopper
(l'affiche est une vraie note d'intention) semblent prendre vie,
notamment grâce à la belle photo de Michael Coulter. Ce sont ces
inspirations qui font tout l'intérêt de The Neon Bible, la dramaturgie du récit ne retrouvant pas l'hypnotique et poignante touche flottante de Distant Voices, Still Lives et The Long Day Closes,
et ne convaincant pas pleinement dans une narration classique (le final
très sombre bien qu'annoncé tombe comme un cheveu sur la soupe). Un
intéressante œuvre de transition où Davies se déleste de quelques
réflexes avant la grande réussite de Chez les heureux du monde.
Film assez difficile à trouver, il n'existe qu'un dvd coréen (lisible sur les lecteurs français) sans sous-titres !
Extrait
Pages
▼
lundi 30 septembre 2019
mercredi 25 septembre 2019
Hana et Alice mènent l’enquête - Hana to Arisu Satsujin Jiken, Shunji Iwai (2015)
Alice intègre un
nouveau collège où circule une étrange rumeur concernant un meurtre commis un
an plus tôt. La victime est un mystérieux "Judas". Une de ses
camarades de classe et voisine, Hana, vit recluse chez elle. De nombreux
commérages courent à son sujet, notamment le fait qu'elle connaîtrait des
détails à propos de l'affaire "Judas". Un jour, Alice pénètre
secrètement dans la maison de Hana mais celle-ci l'y attend déjà. Pourquoi Hana
vit-elle isolée du monde ? Qui est Judas ? Alice décide de mener l'enquête et
se lance dans une aventure qui lui fera découvrir une amitié sincère.
Shunji Iwai semblait avoir offert son ultime chronique
adolescente avec le merveilleux Hana et Alice (2004) mais, dix ans plus tard, l’envie lui prend de revenir à l’univers
d’un de ses films les plus radieux. Il s’agira d’un prequel qui racontera la rencontre entre les deux héroïnes, avec le
choix singulier de le faire sous forme de film d’animation. Cette option
élimine l’écueil de l’âge désormais adulte des actrices Yu Aoi (Alice) et Anne
Suzuki (Hana) qui peuvent donc reprendre leur rôle par le doublage. Bien qu’il
s’agisse de son premier essai dans l’animation, Shunji Iwai possède des
aptitudes certaines pour le dessin, habitué qu’il est à croquer lui-même ses
story-boards et surtout il avait dessiné à l’époque l’adaptation manga d’Hana et Alice.
Le film revient donc sur la période du collège des deux
personnages (entrevue au tout début de premier film) traite de nouveau sous
forme de chronique de la (con) quête d’un garçon. Hana et Alice nouait un
triangle amoureux autour de la coquille vide d’un garçon amnésique que nos
héroïnes nourrissaient d’une mémoire factice afin de s’attacher son cœur. Dans
ce second film, le garçon est au contraire un fantôme, une chimère à poursuivre
et dont le souvenir hante Hana et Alice soit par culpabilité, soit par goût du
mystère. Alice nouvelle venue au collège s’y intègre rapidement et est mise au
fait de la « disparation » d’un élève l’année précédente, la légende
urbaine et les symboles folkloriques nourrissant l’imaginaire de l’établissement.
Hana quant à elle vit recluse dans sa chambre depuis plus d’un an soit
précisément le moment de la disparition du garçon, ce qui laisse à supposer que
les deux évènements sont liés. L’intérêt purement curieux et amusé d’Alice et
celui qu’on devine plus intime d’Hana vont ainsi se rencontrer dans une quête
semée d’embûches pour avoir le fin mot de l’histoire.
Shunji Iwai utilise en partie la technique de la rotoscopie,
qui consiste à d’abord filmer les acteurs en live puis redessiner sur eux l’allure
de leur personnage puis ensuite d’y ajouter des éléments de décor. Cela va
créer une vraie continuité avec le premier film et notamment en retrouvant la
gestuelle singulière des deux adolescentes. On retrouve ainsi toutes les
attitudes facétieuses et bondissantes de Yu Aoi en Alice, savant mélange de
désinvolture et de grâce. Anne Suzuki renoue elle avec la raideur d’Hana,
dissimulant sous les stratagèmes et la distance les émotions qui l’agitent. Les
décors sont eux conçus en 3D CGI, une forme de photo réalisme (rapprochant parfois le film de Makoto Shinkai, de son côté très influencé par les films live de Shunji Iwai) des environnements
se mariant avec la spontanéité du rendu crayonnés et saccadés de l’animation
des personnages. Shunji Iwai s’en amuse en reprenant l’attitude nonchalante
typique des adolescents (démarche le dos raide et traînant les pieds) les
expressions cartoonesques et outrées des visages (déjà bien significatives dans
le film live) et en amenant des
mouvements de caméras juste ce qu’il faut de plus exagérés (la chute d’Alice
dans les escaliers, la poursuite finale) par apport à ses effets de mise en
scène habituels.
On est captivé par la capacité de ses héros juvéniles à
façonner un imaginaire qui en sous-texte est là pour combler des maux qu’ils
peuvent/savent pas exprimer, explicite pour Alice découvrant un nouvel
environnement ou sous-jacent pour Hana et sa fuite du cadre du collège. Sous l’aspect
enjoué, Iwai reprend d’ailleurs certains éléments sombres de ses autres
chroniques adolescentes comme le ijime
(harcèlement scolaire) au centre d’All about Lily Chou-Chou (2001) et qui sera ici résolu d’une manière aussi inventive
que désopilante. Les personnages vulnérables de Shunji Iwai doivent toujours en
passer par des chemins de traverse pour surmonter leurs failles et le
réalisateur se plaît à décanter cela par une révélation, un rebondissement
et/ou une rencontre inattendue. C’est ainsi qu’il nous cueillait dans les dix
dernières minutes envoutantes d’April Story (1998) où toute la rêverie timide qui précédait trouvait tout à coup
un sens - idem pour la conclusion de Love Letter (1995).
Il en va de même ici où une situation cocasse débouche sur un poignant
aveu en flashback (là encore élément déclencheur d’April Story) d’Hana et de retrouvaille qui vont enfin l’apaiser. C’est
d’ailleurs amusant comme Iwai inverse la dynamique d’Hana et Alice où, tout en suivant Hana le déroulement et l’épilogue
fait d’Alice la vraie héroïne. C’est l’opposé ici où les facéties d’Alice
débouchent finalement sur un beau portrait d’Hana. Si le film peut être vu et
apprécié sans connaître la version live, on y perd cependant toutes les belles
réminiscences formelles qui en décuple le plaisir (le cours de danse, des environnements
utilisés de façon différentes, les cadrages sur Alice alanguie dans le métro)
et notamment la si iconique posture d’Hana et Alice en uniforme de collège
devant un parterre de fleur. Sans égaler complètement la réussite de l’original,
c’est un vrai bonheur de renouer avec cet univers et ses personnages, et une
nouvelle preuve des talents multiples de Shunji Iwai.
Sorti en bluray et dvd zone 2 français chez All the anime
mardi 24 septembre 2019
Venez donc prendre le café... chez nous ! - Venga a prendere il caffè... da noi, Alberto Lattuada (1970)
Paronzini recherche un
plan idéal pour contracter un mariage avantageux. Il le trouve grâce à trois
vieilles filles, enrichies par l'héritage de leur père décédé. Invité à boire
le café dans leur confortable villa, Paronzini épouse Fortunata, mais il est
bientôt contraint de les satisfaire toutes les trois...
Alberto Lattuada fait une nouvelle fois montre de la
brillante versatilité de son talent avec cette merveille de comédie italienne. Venga a prendere il caffè... da noi est une adaptation libre du roman La Spartizione de
Piero Chiara paru en 1964. Lattuada y apporte cependant des modifications
majeures qui en changent la portée. Le roman se situe à l’ère fasciste tandis
que le cadre du film est contemporain, le héros vétéran de la Première Guerre
Mondiale en devenant un de la Seconde. Plus globalement, la satire politique qu’offrait
la période du roman devient plus nettement sociale avec le changement d’époque.
Lattuada confronte le machisme ordinaire des hommes comme
des institutions avec leur époque plus libérée et livre un message sarcastique
mais également féministe. Fortunata (Angela Goodwin), Tersilla (Francesca
Romana Coluzzi) et Camilla (Checco Durante) sont trois vieilles filles
fortunées et fraîchement orphelines de leur père. Chacune d’elle véhicule de
manière pathologique un mélange de terreur et d’attirance pour les choses du
sexe, leurs existences isolée à la fois sous le joug de leur père mais aussi
dans cette ville provinciale du nord de l’Italie ne leur ayant pas permis de
véritable contact avec les hommes. Cela fait d’elle des cibles de choix pour
les coureurs de dot les plus divers et médiocres. Paronzini (Ugo Tognazzi) est
l’un d’entre eux, vétéran de guerre blessé masquant sous une attitude vénérable
un savant gout du calcul. Lattuada le caractérise de multiples maniérismes
proprement ridicule supposés asseoir cette prétendue dignité à travers des
aphorismes de pique-assiettes comme ses besoins primaires qu’il définit par les
trois C : caresses, chaleur, commodité.
Si pathétique que puisse paraître
ce personnage de petit fonctionnaire fier de sa personne, cette présence
masculine suffit à impressionner les trois sœurs dont il parvient à pénétrer le
cercle.
A cette masculinité bourgeoise risible, Lattuada en ajoute
une prolétaire tout aussi détestable avec le jeune voisin brocanteur en
faillite qui espère se refaire en séduisant Tersilla qu’il surnomme son « Titien ».
On s’amuse du plan d’action « militaire » de Paronzini repérant,
traquant puis approchant ses proies, scrutant leurs failles pour mieux les
séduire quand le voisin en appelle à une séduction et un appel aux
bas-instincts plus agressifs. Les trois sœurs sont caractérisées dans leur
rigidité par des éléments physiques et vestimentaires qui iront en s’estompant,
se transformant. La sensualité de l’aînée Fortuna se révèle quand sa coiffe
rigide révèle peu à peu une chevelure d’une impressionnante longueur qui se
déploie lors de ses ébats avec Paronzini.
Tersilla affiche une taille
sculpturale et gauche dont la gêne s’efface avec la découverte des plaisirs de
la chair tandis que les attitudes agitées de Camilla vont en s’apaisant dans
les bras d’un homme. Les héroïnes sont tout d’abord soumises aux mœurs de leurs
amants, que ce soit le rituel encore une fois militaire avec lequel Paronzini
retire les chemises de nuits de ses maîtresse ou plus brut de décoffrage les
assauts de chien en chaleur du brocanteur sur Tarsilla. Lattuada inverse le
rapport de force par la composition de plan et la position des amants lors des
scènes d’amour. Paronzini au fil des étreintes ne s’impose plus aux vieilles
filles et c’est au contraire leur libido libérées qui semblent l’écraser. On l’observe
dans des plans où les jambes et autres formes féminines enferment, écrasent
Paronzini dans le cadre, le plaçant à son tour dans une posture de soumission.
Bien que furtive la charge contre l’église n’en est pas
moins virulente avec une institution préférant masquer les apparences des
moyens indignes (une lettre anonyme servant un guet-apens honteux) ou une
façade qui constituerait une prison de plus pour les femmes. Les hommes
chuteront par leur présomption machiste, le brocanteur trop sûr de sa séduction
et Paronzini de ses capacités sexuelles menant la « campagne » de
trop en cherchant à entreprendre la jeune et jolie domestique. C’est finalement
lui qui sera vidé par la vigueur enfin libérée des figures féminines et en
écho ironique, la scène finale répond à un leitmotiv visuel du film (Paronzoni
paradant comme un coq en ville au bras des trois sœurs) où les sœurs trimballent
la loque qu’est désormais Tognazzi en arborant enfin des tenues sexy de jeunes
femmes de leur temps.
Sorti en dvd zone 2 français chez Tamasa