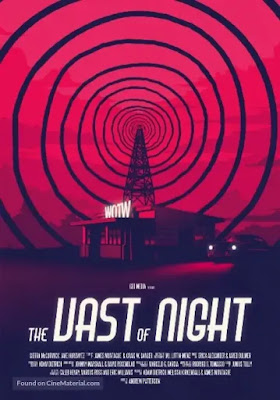Un tueur hante les routes désertiques en se faisant passer pour un auto-stoppeur auprès des rares voitures qui croisent son chemin. Bientôt traqué, il se résout à fuir en menaçant deux pêcheurs qui le conduisent jusqu'au Mexique. Contraints par le porteur du pistolet, les deux hommes ne parviennent pas à se libérer de son joug.
Le Voyage de la peur se démarque au sein de la filmographie d’Ida Lupino qui explore le plus souvent des thématiques sociales et féministes rattachés à des personnages placés à la marge par les circonstances (Outrage (1950) et Never Fear (1949) notamment). Le Voyage de la peur est un pur thriller qui au premier abord s’éloigne de ces préoccupations. Le scénario (cosigné par Ida Lupino) s’inspire d’un vrai fait divers qui vit le criminel Bill Cook assassiner six personnes qui eurent le malheur de le prendre en stop en Californie et dans le Missouri entre 1950 et 1951. Ida Lupino s’empare du sujet pour un remarquable dosage entre suspense et étude de caractère.
L’ouverture muette est absolument glaçante, faisant du tueur Emet Myers (William Talman) une silhouette invisible et funeste semant la mort chez les malheureux automobilistes ayant eu le malheur de le prendre à bord. Son visage est absent à l’écran si ce n’est une coupure de journaux révélant son identité, et les conséquences de ses actes ne se révèlent que dans un silence froid où l’on n’aperçoit que son pas impassible quittant les lieux du crime (dans un principe qui préfigure En Quatrième vitesse de Robert Aldrich (1955)). Dès lors toute montée de tension est inutile lorsque Myers s’introduit dans le véhicule des deux amis Roy (Edmond O'Brien) et Gilbert (Frank Lovejoy). Nous avons déjà assisté au commencement et à l’issue des fatidiques périples de Myers et Ida Lupino va au contraire explorer ce qui n’a pas été vu, à savoir la confrontation entre le tueur et ses victimes un tournant violent attendu. La réalisatrice désacralise son méchant après l’avoir iconisé et rendu mystérieux une dernière fois lorsque son visage est plongé dans l’ombre installé sur la banquette arrière. Myers est un être pathétique dont le sentiment de toute puissance ne tient qu’au revolver qu’il tient solidement à la main. Dans un thriller classique, on scruterait les ouvertures quant aux situations où nos héros à deux contre un profiteraient d’un moment d’inadvertance de leur adversaire pour le neutraliser. Mais Lupino ne pose aucun de ces creusets scénaristiques qui amorcerait la chose pour au contraire dresser un road-movie inquiétant sans vraie grande péripétie. L’idée est d’opposer la folie dans tout ce qu’elle a d’imprévisible et pitoyable à la peur ordinaire et l’instinct de survie. Face au répugnant Myers, tout faux-pas se paie potentiellement cash et cette crainte noue le ventre des quidams lambda que sont Roy et Gilbert. Myers cherchera d’ailleurs à briser ses otages en jouant sur les aptitudes qui auraient pu les rendre dangereux pour lui. La scène où il fait tirer Gilbert à distance sur Roy altère la témérité du premier et expose la vulnérabilité du second. Cette mise à nu s’exprime par l’évolution des environnements traversés. On s’éloigne progressivement de la civilisation pour se perdre dans des lieux reculés puis le désert, comme pour traduire la folie comme la terreur exposée des personnages. Lors de leur tentative d’évasion nocturne, Roy et Gilbert le temps d’une saisissante contreplongée sont comme des enfants apeurés dominé par l’arrivée en voiture puis la silhouette de Myers qui les a rattrapés. Le taciturne Gilbert est le plus préparé (un dialogue en début de film indique qu’il a fait la guerre) tandis que le loquace Roy est le plus vulnérable malgré les joutes verbales qu’il entame avec son ravisseur. Le traumatisme de l’aventure se ressent par sa perte de repère comme lorsqu’il fond en larmes en voyant un avion survoler leur campement sans les voir, mais surtout lors de ce final tout sauf vengeur où il tabasse un Myers menotté. On quitte en fait des êtres tout aussi brisés et hébétés que la jeune femme violée d’Outrage. Sauf que dans ce dernier le traumatisme était capturé en ellipse tandis qu’il constitue le cœur de Le Voyage de la peur, sans espoir de reconstruction. Remarquable.Ressortie en salle cette semaine