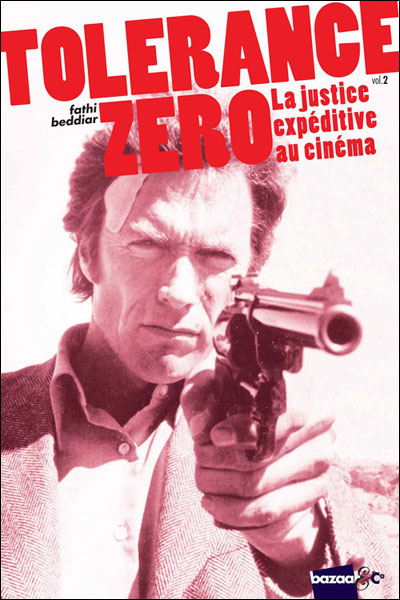Disparu dans un relatif oubli en 2011, Ken Russell fut une des figures les plus importantes du cinéma anglais des années 70/80. Son style baroque et excessif, son goût pour la provocation et le scandale fit de ses films de vrais évènements médiatiques durant sa grande période notamment le fameux Les Diables (1971). The Music Lovers arrive à un moment où la carrière du réalisateur est en pleine ascension. Après avoir principalement œuvré pour la télévision, Russell s’était fait remarquer en dynamitant le troisième volet de la saga d’espionnage des Harry Palmer, Un cerveau d’un milliards de dollars (1967). Le côté espionnage décalé des deux précédents épisodes prend un tour plus fou et iconoclaste sous l’impulsion de Russell qui transforme l’ensemble en James Bond sous acide détonant.
Ce premier
tour de force lui permet d’être engagé pour la mise en scène de Women in love (1969), adaptation du
roman éponyme de DH Lawrence. En apparence plus sobre et académique, le film se
démarque pourtant de l’adaptation sage attendue. Ken Russell truffe le film
d’inventions formelles et de rupture de ton déroutantes pour dépeindre ces
chassé-croisé amoureux, tout en y posant certaines de ses obsessions comme
l’homosexualité au cœur de The Music
Lovers justement. Women in love
recevra un excellent accueil public et critique, Glenda Jackson remportant même
l’Oscar de la meilleur actrice.
La voie était toute tracée pour Ken Russell plus libre dans
ces réalisations suivantes ce qui se manifeste donc dès le film suivant qu’est The Music Lovers. Le film s’inscrit dans
un cycle que Russell consacre au biopic de grands compositeurs auxquels
s’ajouteront Mahler (1974), Lisztomania
(1975) et précédé à la télévision par Bartok
(1964) ou Elgar (1962). Ici il sera
question de retranscrire l’existence de Tchaïkovski. Russell choisit bien
évidemment un angle controversé en évoquant le sujet tabou (encore aujourd’hui
en Russie) de l’homosexualité de du compositeur incarné par Richard
Chamberlain.
A travers les tourments
existentiels que lui cause son penchant, Tchaïkovski exprime un thème au cœur
de nombres des œuvres de Russell, la quête (et son échec) de la grande passion
amoureuse. Chez Russell cette obsession est synonyme d’aveuglement et de
risques insensés pour l’atteindre comme héros de Women in love, et face à la fadeur du monde réel les personnages se
réfugie dans l’artifice et les apparences tel la Kathleen Turner schizophrène des Jours et Nuit de China Blue.
Cela est parfaitement exprimé dans une des premières scènes
de The Music Lovers, lorsque Tchaïkovski
joue sa première grande symphonie devant un public. Là, dans un tourbillon de
rêveries, fantasmes et de flashback défilent les espérances amoureuses impossibles
du compositeur mais aussi celle de son amant le comte Anton Chiluvsky, de sa future épouse Antonina Milioukova
(Glenda Jackson), sa sœur au désir incestueux Sasha et l’admiratrice
silencieuse Nadejda Von Meck.
Tous représentent une des possibles aspirations
amoureuses de Tchaïkovski, toutes vouées à l’échec. L’assouvissement des sens
interdit par la morale avec son amant, une normalité qui le dégoutte avec son
épouse ou une communion spirituelle illusoire avec la mécène Nadejda Von Meck
forment tous autant d’impasse dans ce désir d’absolu.
Russell fait passer tout
cela par la seule force de l’image (les dialogues sont plutôt rares) et son
sens de l’excès, notamment le jeu outrancier et expressifs des acteurs
notamment une Glenda Jackson à l’abandon impressionnant. Russell sait aussi faire
preuve d’une vraie finesse sous les écarts visuels dont cette scène où les
personnages assistent à une représentation du Lac des Cygnes.
La connaissance de l’intrigue l’Opéra et le montage aventureux permet de
faire un rapprochement logique avec la situation précaire du triangle
amoureux : l’épouse est le cygne noir qui conduira le Prince Siegfried/
Tchaïkovski à sa perte et le cygne blanc son amour fidèle. Le degré de
fascination sera tout aussi grand dans la manière dont Russell illustre l’amour
platonique et épistolaire entre Tchaïkovski et Nadejda Von Meck, ce qui est
somme toute logique puisque le film s’inspire de leur correspondance recueillie
par Catherine Drinker Bowen spécialiste des biographies de grands musiciens.
La Russie du XIXe vue par Russell est un reflet mental des personnages.Les visions de Moscou et Saint-Pétersbourg alternent entre imagerie de contes de fée et pure confusion grotesque selon les sursauts créatifs de Tchaïkovski.. On appréciera la reconstitution somptueuse dans la demeure de Nadejda Von Meck dont les vastes intérieurs dévoilent son esprit romanesque et rêveur. Il y a tellement de détails et d’éléments sous-jacents qu’une vision ne suffit pas à savourer la splendeur de The Music Lovers, notamment la magnifique photo de Douglas Slocombe.
Sorti en dvd zone 2 français chez Bel Air
Extrait
Sorti en dvd zone 2 français chez Bel Air
Extrait