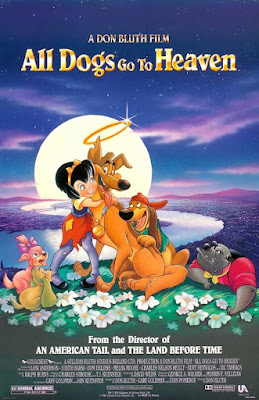This Sspoting Life est le premier long-métrage de Lindsay Anderson, qui emboite alors le pas à ses amis Tony Richardson et Karel Reisz. Avec ces derniers, il s’imposa comme critique et théoricien du cinéma, dont les idées et concepts devaient déboucher sur la fondation du Free Cinema à la fin des années 50. Tony Richardson se lance en 1958 avec Les Corps sauvages tandis que Karel Reisz fait de fracassant débuts dans Samedi Soir, Dimanche Matin (1960). Il y a un vrai parallèle à faire entre les premiers titres majeurs des trois réalisateurs, qui adaptent chacun un auteur emblématique du courant des angry young men (Alan Sillitoe sur La Solitude du coureur de fond de Tony Richardson (1962) et Samedi soir, Dimanche Matin), dépeignent justement des héros juvéniles et rugueux en opposition contre le système, et joués par d’illustres inconnus qui crèveront l’écran pour devenir d’immense stars du cinéma anglais (Albert Finney chez Reisz, Tom Courtenay avec Richardson). Lindsay Anderson semble suivre en tout point leur parcours, This Sporting Life étant l’adaptation du roman éponyme de David Storey (publié en 1960) qui en signe le scénario, et servira de formidable tremplin à Richard Harris qui trouve là son premier grand rôle. Le film est initialement proposé à Karel Reisz qui, y voyant les évidentes similitudes avec Samedi Soir, Dimanche Matin, recommande Lindsay Anderson (jusque-là uniquement responsable d’une dizaine de court-métrages) et se contente d’être producteur.
Les sujets voisins et le type de héros voisins de Samedi Soir, Dimanche Matin, La Solitude du coureur de fond et This Sporting Life, permettent par leur différence de brosser un véritable portrait de chacun des réalisateurs. Le lad farceur de Reisz fuit la sinistrose de son quotidien par la fuite en avant rigolarde, celui taciturne de Richardson tourne le dos à la réussite sportive et sociale par intégrité morale. Frank Machin (Richard Harris), est un ancien mineur qui entrevoit l’ascension aussi par le prisme du sport lorsqu’il est enrôlé dans l’équipe de rugby à 13 de la ville. Tant sur le terrain que dans la vie, son attitude agressive et arrogante témoigne d’une rage de réussir inébranlable. Peu à peu se dessine pourtant un caractère bien plus attachant et passionné quand cette quête de gloire s’avérera être l’atour de conquête de l’élue de son cœur, Margaret (Rachel Roberts). Cette dernière est une veuve et mère de famille, logeuse de Frank, cette promiscuité incitant notre héros à manifester ses sentiments de façon de plus en plus ardente. Mais Margaret vit dans le souvenir figé de son époux défunt, et rabroue Frank à chaque tentative de rapprochement. La gloire sportive et la réussite matérielle qui en découle n’est donc pas un objectif narcissique pour Frank, mais le moyen de se faire aimer de Margaret en lui offrant une vie meilleure. La droiture et l’intransigeance morale des angry young men se retrouve ici dans l’attitude de Frank face aux tentations que lui offre sa nouvelle notoriété. Supportrices peu farouches, possessions de luxe et accès aux lieux les plus huppés de cette petite ville de Wakefield, tout cela, Frank le lorgne sans jamais réellement y goûter. De chaque tentations et plaisirs superficiels, il se détourne pour inlassablement revenir vers sa logeuse qui se refuse à lui. Lindsay Anderson adopte une mise en scène fluide et nerveuse lors des joutes sportives, mettant en valeur la teigne et le roc qu’est Frank sur les terrains, sortant vainqueur de « l’enfer du dimanche » devant une foule ébahie qui va en faire la star locale. Toute cette aura de surhomme s’estompe dans l’intimité de la maison, lorsqu’il alterne entre colère, douceur et désespoir face aux refus de Margaret. Anderson filme Richard Harris avec une formidable puissance dans ces instants-là, dans ce qui constitue la véritable joute du récit à travers cette romance torturée. Richard Harris est tout simplement stupéfiant d’intensité, tant dans les instants où son dépit lui fait adopter des comportements discutables, que quand il presque s’arracher le cœur pour le déposer aux pieds de Margaret. Une scène va d’ailleurs mettre à genou le spectateur face au lâcher-prise de Harris, lorsqu’il déclame à son ami l’intensité de son amour pour cette femme, la seule lui faisant ressentir le besoin d’être désiré – le jury cannois ne s’y trompera pas en lui décernant le prix d'interprétation lors de l’édition 1963 du festival. La narration en partie en flashback, par ces parallèles entre un Frank ardent et plein d’espérance puis celui brisé physiquement comme moralement, entremêle tension dramatique et de brillantes idées formelles par son travail sur le montage et les raccords. La trajectoire tragique du dieu du stade se dessine ainsi dès le départ, la gloire éphémère en miroir de l’inévitable déchéance, jusqu’à un final poignant où la hargne s’est envolée, où la raison d’être du combat n’est plus. Grand film.Sorti en dvd zone 2 français chez Doriane Films