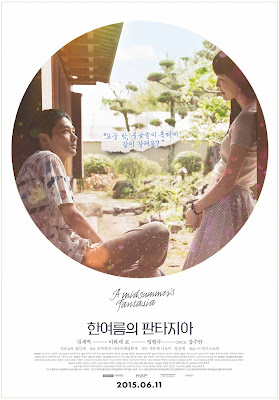Refusant de faire
carrière en tant que petite frappe dans la pègre locale, Chiu décide de devenir
maître cuisinier. Introduit dans un restaurant, il devient le larbin du patron
et le nouveau favori de sa fille, passablement excentrique. Le restaurant se retrouve
menacé par un maître cuisinier mongol, qui lui lance le défi du Festin
Chinois...
Une des thématiques récurrentes de Tsui Hark repose sur le
questionnement voire l’opposition entre la tradition et la modernité. Le
réalisateur l’aura exploité dans diverses approches. Sociale avec le rageur L’Enfer des armes (1980) et ses
terroristes en herbe en colère contre la société hongkongaise. Historique avec
la refonte du héros chinois Wong Fei Hung dans la saga Il était une fois en Chine. Philosophique avec la relecture du conte
traditionnel dans Green Snake (1993)
et même romanesque avec le magnifique The Lovers (1994) et Histoires de fantômes chinois (1987) qu’il produit. Dans cet ensemble Tsui Hark témoigne
d’une schizophrénie entre respect pour les traditions (la vraie dimension
nostalgique et les clins d’œil aux précédentes versions filmées des contes qu’il
adapte) et une volonté de les bousculer en profondeur dans le fond et la forme
(le message féministe introduit dans Green
Snake, le patriotisme de Wong Fei Hung discuté, The Lovers et ses étonnantes tendances queer, l’horreur façon Evil Dead de certains moments d’Histoire de fantôme chinois).
Le Festin chinois
est une des approches les plus ludiques de ce thème pour Tsui Hark, en plus d’être
une de ses œuvres les plus populaires à Hong Kong. Le film est au départ une
commande pour le grand film populaire de fin d’année à Hong Kong et Tsui Hark
décide d’y traiter un sujet qui lui trotte à l’esprit depuis longtemps, l’illustration
et l’ode à la cuisine chinoise traditionnelle. Tout dans le récit tourne autour
de cette réflexion entre tradition et modernité. Le héros Chiu (Leslie Cheung)
aspire à quitter sa carrière de petite frappe pour être cuisinier quand Au
Ka-Wai (Anita Yuen) la fille excentrique de son patron rejette cet héritage et
rêve d’une carrière de chanteuse. Cette tradition va se voir menacée par le
défi d’un maître cuisinier mongol : le vainqueur du duel dans la
réalisation du mythique Festin Chinois deviendra propriétaire du restaurant
familial. La voracité capitaliste et les expérimentations culinaires de l’adversaire
(Hung Yan-yan qui entre The Blade et Il était une fois en Chine 3 compose
toujours des méchants mémorables chez Tsui Hark) impose donc un versant sombre
de la modernité dans une volonté industrielle d’écraser les autres.
Pour nos
héros au contraire ce sera une forme d’accomplissement et de trouver un sens à
leur jeunesse oisive, voire même une rédemption pour le maître cuisinier déchu
Kit (Kenny Bee) qui a autrefois tout perdu pour son art.Tout cela est amené avec une bonne humeur réjouissante par un
Tsui Hark déployant une énergie folle même s’il nous perd un peu par une entrée
en matière hystérique façon comédie cantonaise bien grasse. Dès que l’enjeu
culinaire se pose, l’ensemble devient captivant avec un Tsui Hark à la fois
didactique et virevoltant pour nous faire découvrir les arcanes de la cuisine
chinoise. Les origines du fameux Festin chinois offrent un aparté historique
passionnant tandis que la remise sur pied de Kit offre d’hilarants moments
comiques pour lui faire retrouver la perfection indispensable de ses cinq sens.
Ce dernier point introduit d’ailleurs l’illustration de la cuisine par Tsui
Hark lors de l’affrontement final.
On reste dans la tradition avec la description
pittoresque des plats constituant le Festin (patte d’ours, trompe d’éléphant et
cervelle de singe au menu entre autre), cette excentricité se prolongeant
dans la préparation où Tsui Hark inclut les codes du cinéma d’arts martiaux
avec les techniques virtuoses de nos cuisiniers. Les légumes se découpent en un
coup de couteau savamment asséné, les bottes secrètes permettent d’introduire
une saveur inattendue et nous ne sommes jamais perdus puisque Tsui Hark
introduit même les codes du manga avec les jurés observant et faisant des
commentaires instructifs durant l’exécution délirante des plats.
Le réalisateur
rend l’ensemble alléchant et olfactif par cette approche qui creusera l’estomac
de tout spectateur qui oubliera l’exotisme des plats (et une caution SPA
faisant office d’excellent rebondissement). Les personnages attachant
contribuent également à nous emporter dans ce monde inconnu, notamment le
couple formé par Leslie Cheung (que l’on a rarement l’occasion de voir dans ce registre
de comédie, dans ses rôles parvenus en France du moins) et l’exubérante Anita
Yuen. Un des films les plus lumineux et enjoué du réalisateur.
Sorti en bluray et dvd zone 2 chez Spectrum films