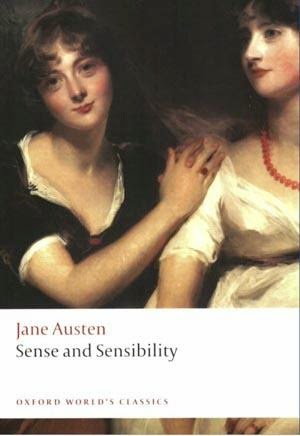Policier intègre, Serpico lutte contre la corruption généralisée au sein de la police new-yorkaise. Détesté de tous, collègues comme supérieurs, il ne pourra compter que sur lui-même pour mener à bien sa croisade pour la justice.
Au début des années 70, la ville de New York est financièrement au bord du gouffre. Le malaise est tel qu’une grève des éboueurs pour salaires non versés entraînera une insalubrité dangereuse dans les quartiers les plus défavorisés et causera des violences des minorités révoltées par cet abandon. Paradoxalement, la ville sortira de cette impasse en ouvrant ses rues aux studios de cinéma qui des drames comme Macadam Cow-boy au polar tel ce Serpico diffuseront à travers le monde cette imagerie sordide et menaçante. Dans ce contexte où les instances s’avèrent si démunies, être policier n’est pas chose aisée face à une criminalité galopante et les tentations sont grandes. S’il ne la justifie pas, ce cadre délétère explique en tout cas le basculement de certains vers la corruption désormais vue comme une chose naturelle. Quelle place alors pour un flic réellement vertueux et propre ?
 C’est la grande question du film de Lumet qui adaptait là le roman de Peter Maas inspiré du réel destin de Frank Serpico ici incarné par Al Pacino. On accompagne ainsi le lent désenchantement d’un jeune flic idéaliste qui va constater à quel point la gangrène de la corruption ronge la police. Dénué de vraie intrigue linéaire, le récit accompagne Serpico à différents moments de sa carrière et de sa désillusion croissante sur son métier, ses collègues et ses dirigeants. Lumet articule cette faillite de la police de manière croissante selon les fonctions qu’occupe Serpico. Encore jeune policier en uniforme idéaliste, Serpico se confronte à des confrères blasés (« ce n’est pas notre secteur » lancé par son coéquipier lors d’un appel pour une tentative de viol) et guère motivé par la défense du citoyen. Après une arrestation courageusement tentée en solitaire, il se voit ainsi voler le crédit de son action par ceux même ayant refusé de l’aider sous prétexte hiérarchique.
C’est la grande question du film de Lumet qui adaptait là le roman de Peter Maas inspiré du réel destin de Frank Serpico ici incarné par Al Pacino. On accompagne ainsi le lent désenchantement d’un jeune flic idéaliste qui va constater à quel point la gangrène de la corruption ronge la police. Dénué de vraie intrigue linéaire, le récit accompagne Serpico à différents moments de sa carrière et de sa désillusion croissante sur son métier, ses collègues et ses dirigeants. Lumet articule cette faillite de la police de manière croissante selon les fonctions qu’occupe Serpico. Encore jeune policier en uniforme idéaliste, Serpico se confronte à des confrères blasés (« ce n’est pas notre secteur » lancé par son coéquipier lors d’un appel pour une tentative de viol) et guère motivé par la défense du citoyen. Après une arrestation courageusement tentée en solitaire, il se voit ainsi voler le crédit de son action par ceux même ayant refusé de l’aider sous prétexte hiérarchique.Cette marginalisation progressive va bientôt se manifester de manière plus concrète dans la tenue vestimentaire. Alors que même les officiers les plus « borderline » comme l’Inspecteur Harry affiche toujours un impeccable veston de ville (et ainsi repérable des lieues en amont par les criminels), Serpico révolutionne l’image du flic au cinéma avec un Al Pacino à la chevelure hirsute, barbe foisonnante et fripes évoquant plus la communauté hippie de Greenwich Village. La télévision surtout saura s’en souvenir puisque des séries aux héros classiques comme Les Rues de San Francisco vont bientôt laisser place au Robert Blake, roi du déguisement de Barreta ou du duo décontracté de Starsky & Hutch.
 Cet aspect très voyant en cache un bien plus problématique. Serpico dans sa droiture morale est un homme souhaitant s’élever l’esprit, se cultiver. Dès lors, face aux conversations terre à terre et à la bêtise crasse des autres flics, on comprend qu’il ne sera jamais l’un des leurs. Le film dresse un constat très pessimiste, Serpico se confrontant au corporatisme en plus haut lieu et voyant l’étau se resserrer sur lui. On passe en effet du repas gratuit offert à une collecte savamment organisée et aux montants de plus en plus élevés selon les quartiers et unités. Le style urbain et sur le vif adopté par Lumet s’alterne ainsi avec des moments plus intimistes où Serpico désespère de sa condition.
Cet aspect très voyant en cache un bien plus problématique. Serpico dans sa droiture morale est un homme souhaitant s’élever l’esprit, se cultiver. Dès lors, face aux conversations terre à terre et à la bêtise crasse des autres flics, on comprend qu’il ne sera jamais l’un des leurs. Le film dresse un constat très pessimiste, Serpico se confrontant au corporatisme en plus haut lieu et voyant l’étau se resserrer sur lui. On passe en effet du repas gratuit offert à une collecte savamment organisée et aux montants de plus en plus élevés selon les quartiers et unités. Le style urbain et sur le vif adopté par Lumet s’alterne ainsi avec des moments plus intimistes où Serpico désespère de sa condition.Devenue une menace pour ses collègues mais aussi ses dirigeants dont il dénonce l’immobilisme, Serpico est un héros en sursis comme le montrera la boucle que forme l’ouverture et la conclusion d’une noirceur sans appel. Lumet signait là une de ses grandes réussites, bien aidé par la prestation habitée de Pacino. Ce n’est pourtant que le premier édifice d’une entreprise qui révélera toute son ambition avec Le Prince de New York (1981)puis Contre-Enquête (1990) dans ce qui est la grande trilogie policière (auquel on peut ajouter en sortant du polar le méconnu Dans l'ombre de Manhattan) consacrée à la corruption au centre de la filmographie du regretté Sidney Lumet qui nous a quitté récemment.
Sorti en dvd zone 2 français chez Studio Canal