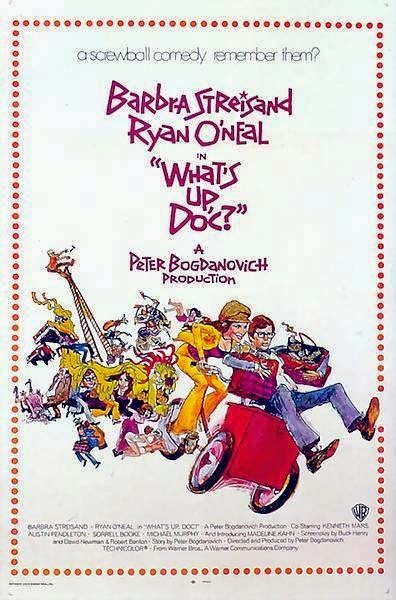Classique absolu du cinéma anglais, Odd Man Out est pour Carol Reed et James Mason le film de la reconnaissance internationale et une œuvre qui constituera une évolution majeure pour chacun d’eux. Carol Reed est encore à l’époque un metteur en scène au talent certain mais difficile à cerner dans ses thématiques et motifs stylistiques. Tout comme Michael Powell, il débute au milieu des années 30 en mettant en scène des "quota quickies", ces courts films en forme de complément de programme salle pour les productions américaines. Dans cette veine, sa plus belle réussite sera Bank Holiday (1938), tranche de vie d’un groupe de personnages ordinaires profitant du weekend de congé donnant son titre au film. On est là assez éloigné des thrillers haletant qui feront la renommée de Reed, tout comme dans son autre succès avec Margaret Lockwood, The Stars look Down (1940), qui fait montre des mêmes préoccupations sociales avec la description d’une communauté minière du nord de l’Angleterre. Lorsqu’il donnera enfin dans le suspense, dur de distinguer complètement sa patte sur Train de nuit pour Munich, excellent film d’espionnage et variante référencée (car signée des mêmes scénaristes Sidney Gilliat et Frank Launder) de Une Femme disparaît (1938) d’Alfred Hitchcock. La fresque historique The Young Mr Pitt (1942) souffrira des mêmes maux avec un contexte et un message sous-jacents rappelant Lady Hamilton d’Alexander Korda. Invisible ou sous influence, le style de Carol Reed ne se révèlera donc qu’avec Odd Man Out, le sujet lui donnant enfin manière à s’exprimer de façon personnelle.
Pour James Mason, la problématique est différente. L’acteur est à ce moment-là la plus grande star masculine anglaise grâce au succès commercial des mélodrames tournés pour la Gainsborough. Il se spécialise alors dans les rôles de méchants flamboyants et outranciers, dans les mélodrames en costumes survoltés que sont The Man in Grey (1943) ou The Wicked Lady (1945). Des films aux excès jubilatoires mais qui l’enferment dans une sorte de caricature dont il cherchera à se sortir après They Were Sisters (1945), dernier rôle de ce type comme chef de famille tyrannique. Le succès de Huit heures de sursis lui ouvrira les portes d’Hollywood et la possibilité de dévoiler un registre bien plus riche que ce qui lui valu d’être surnommé par la critique anglais « the man they loved to hate ». L’équilibre du film tiendra donc aux preuves paradoxales qu’ont à faire le réalisateur et sa star. Carol Reed devra enfin afficher un style visible et personnel pour imposer l’atmosphère que réclame le script de R.C. Sherriff (adapté du roman éponyme de F.L. Green) et James Mason à l’inverse se rendre invisible avec une prestation aussi intense que sobre, loin de l’extravagance qui a fait sa gloire. L’acteur si célébré pour son charisme, sa prestance et sa diction suave trouve ainsi l'un de ses rôles majeurs (c'était d'ailleurs de son propre aveu sa meilleure performance) avec un personnage totalement effacé.
Dès l'ouverture, Carol Reed escamote toutes les occasions qui lui sont donnée de mettre en valeur sa star. Le film ne débute pas avec lui mais un de ses acolytes rejoignant la réunion secrète de l'organisation et on arrive à la fin du discours où il échafaudait les dernières lignes de leur prochaine action, un hold up servant à financer leur mouvement. Privé d'affirmer sa position de chef à l'écran, Johnny McQueen (James Mason) se voit même remis en cause en privé au détour d'un dialogue nous révélant qu'en cavale après une évasion, il n'est pas dans les meilleures disposition physique pour mener l'opération. D'emblée se ressent une lassitude mentale chez le personnage qui nous fait douter de lui, ce que confirmera sa faiblesse qui fera du hold up un fiasco.Pour James Mason, la problématique est différente. L’acteur est à ce moment-là la plus grande star masculine anglaise grâce au succès commercial des mélodrames tournés pour la Gainsborough. Il se spécialise alors dans les rôles de méchants flamboyants et outranciers, dans les mélodrames en costumes survoltés que sont The Man in Grey (1943) ou The Wicked Lady (1945). Des films aux excès jubilatoires mais qui l’enferment dans une sorte de caricature dont il cherchera à se sortir après They Were Sisters (1945), dernier rôle de ce type comme chef de famille tyrannique. Le succès de Huit heures de sursis lui ouvrira les portes d’Hollywood et la possibilité de dévoiler un registre bien plus riche que ce qui lui valu d’être surnommé par la critique anglais « the man they loved to hate ». L’équilibre du film tiendra donc aux preuves paradoxales qu’ont à faire le réalisateur et sa star. Carol Reed devra enfin afficher un style visible et personnel pour imposer l’atmosphère que réclame le script de R.C. Sherriff (adapté du roman éponyme de F.L. Green) et James Mason à l’inverse se rendre invisible avec une prestation aussi intense que sobre, loin de l’extravagance qui a fait sa gloire. L’acteur si célébré pour son charisme, sa prestance et sa diction suave trouve ainsi l'un de ses rôles majeurs (c'était d'ailleurs de son propre aveu sa meilleure performance) avec un personnage totalement effacé.
Huit Heures en Sursis fut à l'époque un film précurseur et risqué au sein du cinéma anglais en adoptant le point de vue d'un rebelle irlandais. Le scénario n'en est pas moins critique envers le choix d'une action armée symbolisée par la lente dérive de James Mason. Celui-ci a en effet franchi la ligne qui sépare l'opposant politique du meurtrier en abattant un homme qu'il n'a su maîtriser lors du vol. La faiblesse mentale cède à une plus physique qui va le ronger pour le reste du film où blessé et mourant il va entamer un véritable chemin de croix à travers un Belfast nocturne et oppressant où il est traqué de toute part.
James Mason offre une prestation stupéfiante avec un personnage pourtant totalement inactif, à la présence de plus en plus spectrale qui ne laisse aucun doute sur sa destinée. Tantôt totalement absent, tantôt délirant le temps de surprenantes séquences oniriques orchestrées par Carol Reed, c'est une longue et douloureuse odyssée qu'effectue là Johnny McQueen. Reed, grandement inspiré par le réalisme poétique français (l'atmosphère nocturne pesante, la photographie sombre et l'illustration de l'architecture de la ville n'est pas sans rappeler Les Portes de la Nuit ou Le Jour se lève entre autres) confère une aura hallucinée à cette ville par le regard fiévreux de James Mason.
 Quant à la mise en scène s'abstient de ses effets, c'est la multitude de rencontres du héros qui prolonge le cauchemar partagée entre les quidams prêts à le livrer pour une récompense, d'autres l'abandonnant à son sort par crainte de la police et ceux l'aidant subrepticement afin de ne pas subir les représailles de ses complices.
Quant à la mise en scène s'abstient de ses effets, c'est la multitude de rencontres du héros qui prolonge le cauchemar partagée entre les quidams prêts à le livrer pour une récompense, d'autres l'abandonnant à son sort par crainte de la police et ceux l'aidant subrepticement afin de ne pas subir les représailles de ses complices.Sorti en dvd zone 2 français chez Opening dans la collection "Les Films de ma vie"
Extrait