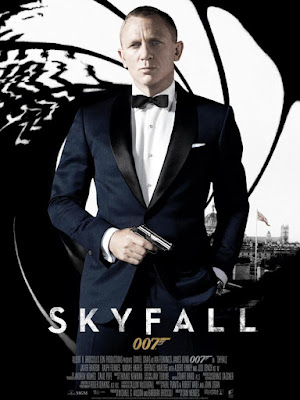Des anges s'intéressent au monde des mortels, ils entendent tout et voient tout, même les secrets les plus intimes. Chose inouïe, l'un d'entre eux tombe amoureux. Aussitôt, il devient mortel. Un film sur le désir et sur Berlin...
Paris, Texas (1985) avait clos pour un temps le cycle de la fascination pour le paysage américain de Wim Wenders et avec Les Ailes du désir, il retrouve son thème de l’errance urbaine à travers un environnement Allemand, celui de la ville de Berlin. C’est clairement une œuvre hommage à la cité Berlinoise que Wenders explore dans une dimension métaphysique, spirituelle et historique. Le métaphysique et le spirituel s’entrecroisent avec ce postulat voyant deux anges Damiel (Bruno Ganz) et Cassiel (Otto Sander) parcourir la ville, à l’écoute de ses habitants et de leurs préoccupations qui nourrissent une voix intérieure commune. Les anges cherchent à apaiser les âmes les plus tourmentées, à éloigner d’eux les pensées les plus sombres, y parvenant parfois, y échouant souvent.
Wenders donne d’un côté un versant tourmenté de ce spleen urbain, mais de l’autre lui confère une tonalité ardente que les anges, et plus particulièrement Damiel, envient de leur seule position d’observateur. Toucher, aimer, gouter, souffrir, sont des sensations auxquelles Damiel aspire, surtout depuis qu’il est tombé sous le charme de Marion (Solveig Dommartin), une jolie trapéziste française exilée à Berlin. Formellement Wim Wenders alterne entre plusieurs approches qui correspondent aux niveaux de réalité du récit. La distance entre les anges et les humains se caractérisent par l’usage du noir et blanc, de différent effet de dilatation du temps et de l’espace correspondant à la perception des anges dépourvues des contraintes temporelles et physiques des humains. Les voix-off s’entremêlent dans la bande-sonore, les cadrages « divins » en plongée sur la ville ainsi que les panoramas urbain immaculés se multiplient.L’envie d’interaction de Damiel se traduit par les brèves interventions de la couleur durant la première partie, tandis qu’en toile de fond se révèlent une dimension référentielle. Peter Falk joue quasiment son propre rôle (des passants le croisant le prennent pour Columbo, son célèbre rôle télévisuel) vient à Berlin tourner un film sur la chute du régime nazi en 1945. Le passé de la ville se révèle dans cette facette méta, mais aussi de manière plus organique grâce au personnage du poète (Curt Bois) dont les tirades et pérégrinations permettent d’insérer les images les plus douloureuses de l’histoire berlinoise : la construction du mur de Berlin, les bombardements subits par la ville durant la Seconde Guerre Mondiale.Cette échelle historique, poétique et cinéphile se ressent dans certaines des images les plus iconiques du film. L’imagerie fantasmagorique qu’instaure Wenders et le mimétisme entre réalisme urbain et féérie façonné avec le monument de Colonne de la Victoire ravivent toute une esthétique rattachée à l’expressionnisme allemand des années 20/30. Lorsque Damiel scrute et frôle une Marion alanguie et solitaire sur son lit, ce sont les fantômes du réalisme poétique français et notamment Jean Gabin/Michèle Morgan de Remorques (1941) qui surgissent, ou encore les films de Jean Cocteau. L’errance et la quête d’amour de Damiel donne l’espérance d’un accomplissent dans une humanité retrouvée grâce aux sentiments. C’est plus insaisissable et trouble dans le cas de Cassiel, même si faute de moyens Wenders ne pourra pas donner de cheminement et conclusion satisfaisants au personnage (qui devait avoir un parcours bien plus tumultueux et torturé en tant qu’humain) et devra attendre pour cela la suite Si loin, si proche ! réalisée en 1993. Toute la première partie en noir et blanc a quelque chose d’intemporel et de fascinant, même si elle s’étire sans doute un peu trop (occupant 1h30 sur les 2h du film). Malheureusement la bascule en couleur où Damiel goutte enfin l’incarnation humaine avec ses hauts et ses bas est bien moins convaincante. L’universalité se perd dans une volonté de s’inscrire davantage dans la contemporanéité berlinoise, mais (sans doute avis biaisé par quelqu’un n’éprouvant pas d’attrait pour la ville) la réalité crue de la ville n’exprime pas le vertige de son pendant plus abstrait. On comprend par la caractérisation de Damiel son émoi d’avoir franchi cette frontière, mais on ne le ressent pas de manière sensorielle. Ce n’est pas quelques graffitis et un stand de street-food qui offrira par l’ancrage réel le pendant de l’émerveillement du début du film qui arpentait pourtant aussi parfois des environnement quelconques. Les caméos de rock-stars de l’époque en concert comme Nick Cave pouvaient endosser ce rôle mais cela semble très artificiel, tout comme la romance bien plus convenue lorsqu’elle est verbalisée que quand elle donnait dans le trouble de la proximité/distance. Malgré ces griefs, Les Ailes du désir reste une œuvre parcourue de certaines images indélébiles et poétique, et parmi les films les plus reconnus de Wim Wenders qui obtiendra le prix de la mise en scène à Cannes en 1987.Sorti en dvd zone 2 français chez Arte Vidéo



.jpg)