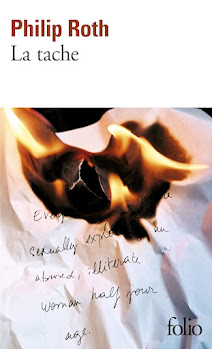À la mort de son père, le jeune Dennis décide de tenter sa chance en ville dans l'espoir de conquérir le cœur de sa dulcinée, Griselda, restée au village. Pendant ce temps, un horrible monstre surnommé Jabberwocky fait régner la terreur, tuant et anéantissant tout sur son passage. Voyant son royaume + menacé, le roi Bruno le Contestable promet la main de sa fille à celui qui terrassera la bête...
Jabberwocky est le premier long-métrage de Terry Gilliam hors du giron de ses facétieux acolytes des Monty Pythons. Après le succès de Monty Python : Sacré Graal (1974) qu’il coréalise avec Terry Jones et dont il signe les séquences d’animation, Terry Gilliam se trouve ainsi dans une position où il est très demandé par les producteurs. Il sera notamment sollicité par Sanford Lieberson pour un projet de film d’animation, avant d’avouer à ce dernier qu’un de ses projets de cœur serait d’adapter Jabberwocky, un des plus fameux poèmes de Lewis Carroll – apparaissant dans son roman De l’autre côté du miroir. Les inventions linguistiques de Carroll inspirent à Gilliam des visions surréalistes qu’il saura traduire par le mélange des genres du film. Le projet se lance pour un budget modeste notamment grâce à l’apport de la branche britannique de la Columbia, tandis que Gilliam va solliciter ses compères Michael Palin en héros et Terry Jones pour un petit rôle – John Cleese préfèrera se tenir en retrait mais se rattrapera en jouant dans Bandits, bandits (1981).
L’un des talents de Terry Gilliam dans la suite de sa carrière sera sa capacité à proposer une imagerie démesurée qui ne fonctionne que par la seule force de sa mise en scène malgré des budgets souvent limités. C’est déjà le cas ici où l’on se trouve dans un Moyen Age où s’entrecroisent dimension rigolarde de Sacré Graal, un réalisme foutraque mais aussi une veine grandiloquente et mythologique oscillant toujours entre premier et second degré. Gilliam détourne les codes du récit héroïque classique, du conte de fée et des codes visuels et narratifs associés au Moyen Age. Ce décalage se ressent dès la première scène où une voix-off narquoise nous dépeint les forces en présences tandis que des dessins évocateurs illustrent des visions dantesques de ce contexte. Tout le film fonctionne ainsi, avec des compositions de plans somptueuses trahissant l’inspiration picturale de Gilliam (on pense plusieurs fois à Pieter Bruegel) mais pour déboucher sur une note rigolarde désamorçant toute solennité. On pense à la première arrivée du roi Bruno the Questionable où le jeu ahuri de Max Wall, la présentation étirée et le décor bricolé sonne plus comme la parodie à la Monty Python. Parfois cela se joue sur le ton telle cette superbe séquence de romantisme pastoral où Dennis vogue en barque vers la maison de sa dulcinée Griselda (Annette Badland). Le reflet de ce ciel couchant sur le cours d’eau, la manière dont s’agence la barque face à la maison dans le cadre et l’usage de musique classique orne ce moment d’une sentimentalité rêveuse bien vite piétinée par les manières rustres de la belle et la fange qui l’entoure. Que ce soit chez les Monty Python ou dans les travaux à venir de Terry Gilliam, toute cette approche à bien sûr une visée plus vaste que le seul humour. Griselda, laide, pauvre et pragmatique ignore le pauvre Dennis qui n’est rien et aspire à un prétendant riche. Elle s’oppose ainsi à la princesse (Deborah Fallender), noble ignorante du monde et attendant comme dans les contes qu’un valeureux prince vienne la conquérir. Cette fois la beauté et la blondeur lumineuse reflète une forme de stupidité moquant le détachement des nantis et anticipant Shrek dans son détournement des archétypes du contes – notre princesse se languissant dans une tour dont l’accès s’avère fort périlleux. On rit donc souvent mais l’identité de Terry Gilliam peine longtemps à se détacher de l’aura des Monty Python. La fulgurance de la tonalité de film à sketches faisait passer toutes les petites baisses de régimes dans les productions du groupe mais Gilliam confronté pour la première fois à un récit au long court peine un bon moment à se détacher d’une approche très décousue. La première partie du récit patine souvent (en oubliant longtemps son antagoniste surnaturel) et souffre de quelques longueurs. Le réalisateur ne propose pas vraiment de neuf à travers ce Moyen Age crasseux et gorgé de trognes grotesques même si on saluera les velléités réalistes et le système D crédibilisant l’ensemble entre deux blagues grivoises ou scatologiques.L’attention se maintient pourtant par la puissance évocatrice de Gilliam qui se manifeste certes par intermittences, mais de manière grandiose. L’humour ne fonctionne jamais mieux que quand il a un enjeux politique sous-jacent, notamment l’intrusion du curieux Dennis dans l’usine de réparation d’armure. Le taylorisme médiéval est mis à mal lorsque Dennis signale aux travailleurs la stupidité de leur organisation dès lors perturbée pour aboutir à un capharnaüm burlesque qui préfigure Brazil. Cet équilibre ténu entre détournement et ancrage mythologique ne prend vraiment que dans la dernière partie, mais de fort belle manière. L’enluminure chevaleresque fonctionne par l’image tout en étant désamorcée par ce combattant si gauche en armure (magnifique plan d’ensemble sous l’arbre). La chanson de geste est empruntée, s’autorise des débordements sanglants inattendus, mais suscite enfin le rire ET l’effroi dans le surréalisme de Gilliam qui confronte peurs primaires et rêveries. Tout Brazil ou Les Aventures du Baron de Münchhausen (1988) sont là en germe à travers ce héros par accident, l’apparition extraordinaire du Jabberwocky dont le design dépenaillé signé Valerie Charlton fait merveille. La créature possède cet aspect à la fois grotesque et terrifiant du rêve qui la rend impressionnante encore aujourd’hui et préfigure le samouraï géant de Brazil ou bien sûr la mort traquant le Baron de Münchhausen. Jabberwocky est ainsi une œuvre passionnante où l’on observe Terry Gilliam se chercher et se trouver avec brio. Si l’influence des Monty Pythons demeure encore dans le suivant Bandits, bandits, il s’intégrera bien mieux désormais pour le réalisateur sûr de sa force, de ce qu’il souhaite raconter ainsi que de la manière de le faire.Sorti en bluray chez Carlotta