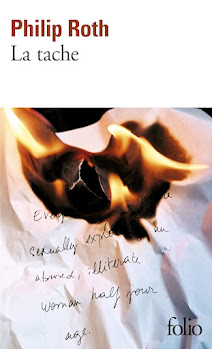Vers l’an 1000, en Castille, en pleine occupation maure, un cheik et ses cent cavaliers s’installent dans un petit village paisible. Couvrant d’abord les habitants de cadeaux, les envahisseurs deviennent vite des tyrans exploitant les villageois. Fernando, un jeune paysan, rassemble des hommes, les entraîne, et se met à la tête de la résistance contre les Maures.
Les Cent cavaliers est une évocation de la Reconquista espagnole, cette période du Moyen-Age qui vit la reconquête par les royaumes chrétiens des territoires de la péninsule Ibérique et des îles Baléares occupés par les maures. Cette période historique connaît un regain d’intérêt dans la fiction avec le monumental Le Cid d’Anthony Mann (1961) qui inaugure les dispendieuses superproductions de Samuel Bronston tournées en Espagne. Cela jouera dans la communication du régime Franquiste d’alors et influencera du coup l’engagement dans des productions locales ou internationales traitant de cette période. Les Cent cavaliers en bénéficiera avec son financement hispano-germano-italien mais Vittorio Cottafavi va largement détourner le récit épique attendu. Cottafavi figure, avec Riccardo Freda ou Pietro Francisi parmi les cinéastes qui durant les années 50 et le début des années 60 creusèrent le sillon d’un cinéma de genre (péplum, cinéma d’aventures) hors du néoréalisme plébiscité par la critique, et sans la reconnaissance dont bénéficièrent les ténors de la comédie italienne. Vittorio Cottafavi parvint notamment dans le péplum à détourner la commande pour amener les récits sur des terrains inattendus, que ce soit Messaline (1959) et sa femme fatale antique ou Hercule à la conquête de l’Atlantide (1961) et sa réflexion sur l’eugénisme.
Les Cent cavaliers est de la même veine avec son approche singulièrement décalée de la Reconquista. L’introduction par sa mise en abyme amusée crée d’emblée une distance tout en montrant géographiquement et politiquement les forces en présence, avec ce village neutre placé entre l’indifférence de la Castille et la possible menace des maures. On va découvrir ses notables en plein égoïsme insouciant à se disputer les recettes de récoltes de blés. Le passage du cheikh Abdelgalbon (Wolfgang Preiss) et ses cavaliers va ainsi imposer l’invasion maure de façon inattendue. Cottafavi sort du cliché de l’envahisseur maure rustre et barbare pour montrer une infiltration sournoise, qui éveille les bas-instincts cupide à coup de flatterie et de présents avant que l’étau tyrannique se resserre. Les villageois creusent leur propre tombe, avant de se rebeller trop tard et de subir la brutale autorité de l’occupant qui les réduit à une main d’œuvre servile. Le film oscille entre sérieux et farce pour un même propos, la chute des peuples s’amorce en leur sein avant d’être exploité par une menace extérieure.Cottafavi convoque donc une tonalité profondément italienne, commedia dell’arte qui préfigure L’Armée Brancaléone (1966) et sa suite Brancaléone s’en va-t-aux croisades (1970) de Mario Monicelli. Cette dimension latine se ressent autant dans la tumultueuse relation amoureuse entre Fernando (Mark Damon) et Sancha (Antonella Lualdi) que dans le pittoresque de certains protagoniste comme la cour des miracles que constitue le groupe de voleur. C’est cependant quand la satire s’applique aux dominants qu’elle est le plus savoureuses. Le cheikh Abdelgabon est paradoxalement trop attentiste pour un envahisseur, sa paranoïa égocentriste voyant dans toutes les maladresses de ses adversaires les manœuvres d’un grand stratège omniscient. C’est pourtant tout l’inverse de ce qu’est Don Gonzalo (Arnoldo Foà survolté dans une prestation à la Gassman), va-t’en guerre idiot et frustré de n’avoir pu guerroyer plus jeune lors d’un précédent conflit avec les maures. Sous la moquerie, Cottafavi distille est message pacifiste où le salut viendra de la génération suivante et les fils de Abdelgabon et Gonzalo, Fernando et Halaf (Manuel Gallardo) aux tempéraments plus paisibles et ouverts l’autre. Le problème du film est de rester trop en surface pour exprimer cette veine progressiste excepté la très belle scène de duel entre Halaf et Fernando. Alors que l’aspect farce domine presque tout le récit hormis quelques sursauts dramatiques (le massacre et les tortures infligés par les maures aux villageois), le rapprochement culturel entre maures et espagnols se résume à des vignettes (la relation entre Halaf et Laurencia (Barbara Frey)) sans véritable développement dramatique. Cela nuit à l’implication émotionnelle à un récit par ailleurs drôle et enlevé. L’approche anti épique est parfois frustrante au vu de l’amorce brillante de certaines scènes (le convoi qui se transforme en armada en un seul plan sur toute la largeur du cinémascope) mais c’est une volonté de Cottafavi de ne pas magnifier et rendre spectaculaire la geste guerrière qu’il juge vaine. C’est particulièrement vrai lors de la bataille finale où après une époustouflante scène de charge à cheval, le combat en lui-même est volontairement confus, grotesque et passe en noir et blanc. Le regard est peut-être trop intellectuel, satirique et finalement distant pour totalement impliquer le spectateur en attente d’aventures. Le film sera d’ailleurs un échec qui sonnera le glas de la carrière cinématographique de Vittorio Cottafavi qui se rabattra sur la télévision. Les Cent cavaliers reste néanmoins un film à voir, son mélange d’élégance et d’approche débraillée détonant dans le film historique de l’époque hormis Tom Jones de Tony Richardson (1963) ou les Brancaléone cités plus haut.
Sorti en dvd zone 2 français chez Artus