Un avocat séduit une femme mariée et
passe la nuit avec elle. Le lendemain matin, le mari arrive au bureau de
l'avocat, affolant l'épouse infidèle, mais sans raison : lui aussi a
découché et sollicite un alibi...
En cette année 1936 et
sous l'influence de sa jeune épouse Jacqueline Delubac, Sacha Guitry
trouve enfin ses marques dans le cinéma pour lequel il se sera montré si
méfiant auparavant. Il s'avérera aussi prolifique qu'au théâtre en
signant quatre films comptant parmi ses plus grandes réussites, tous
adapté de ses pièces : Le Nouveau Testament, Le Roman d'un tricheur, Mon père avait raison et Faisons un rêve. Ce dernier transpose justement une pièce écrite en 1916. Si notamment Le Roman d'un tricheur
avec témoigné pour Guitry d'une certaine jubilation à exploiter toutes
les possibilités narratives et visuelles de l'outil cinématographique, Faisons un rêve
revient à une influence plus typiquement théâtrale. Sur le papier on a
un triangle amoureux de boulevard femme/amant/mari assez typique et le
film est une célébration du verbe virtuose de Guitry à la mise en scène
assez statique. Le plaisir est donc ailleurs dans cette réussite.
Passé
un prologue mondain où l'on croisera du beau monde au casting (Arletty,
Michel Simon...), le récit se resserre pour un brillant jeu de dupe sur
le couple. Ce sera d'abord celui du couple légitime du mari (Raimu) et
de la femme (Jacqueline Delubac). Venu rendre visite à leur ami avocat
(Sacha Guitry) absent, l'époux et sa femme par leurs réactions et
dialogues à double-sens laissent deviner leurs infidélités imminentes
(le "rendez-vous" du mari) ou possible (l'épouse tiquant à la rumeur de
liaison de l'avocat) dans un brillant échange. La bonhomie et la
truculence de Raimu fait merveille face à l'élégante malice de
Jacqueline Delubac.
A l'image de cet échange, toutes les relations de
couple seront affaire de domination où le plus fantasque prendra
l'avantage. Ce sera le cas pour Jacqueline Delubac face à Sacha Guitry
lorsqu'elle le laisse se perdre dans une logorrhée maladroite lorsqu'il
lui déclare sa flamme et surtout quand elle surgira par surprise après
la longue séquence du téléphone où ce dernier nous offre un grand numéro
comique seul à l'écran en amoureux angoissé dans l'attente de sa
dulcinée. Il prendra sa revanche au matin par ses saillies mordantes
alors que Jacqueline Delubac est inquiète d'avoir découché (la réplique
sur la tartine provoquant le fou rire à coup sûr) mais aussi par sa
raillerie subtil de ce mari dont il faut se débarrasser.
L'harmonie
des couples ne peut fonctionner que quand le danger est écarté et
qu'ils peuvent s'adonner librement à leurs passion. D'un coup l'ironie
latente se dissipe pour la fantaisie romantique quand les amants
rejouent leur premier réveil commun manqué et le final endiablé promesse
de volupté. L'énergie, l'esprit et le charme de l'ensemble finit par
totalement en faire oublier le côté statique, un très bon moment.
Sorti en dvd zone 2 français chez Gaumont
[Film] Immaculée, de Michael Mohan (2024)
Il y a 3 heures































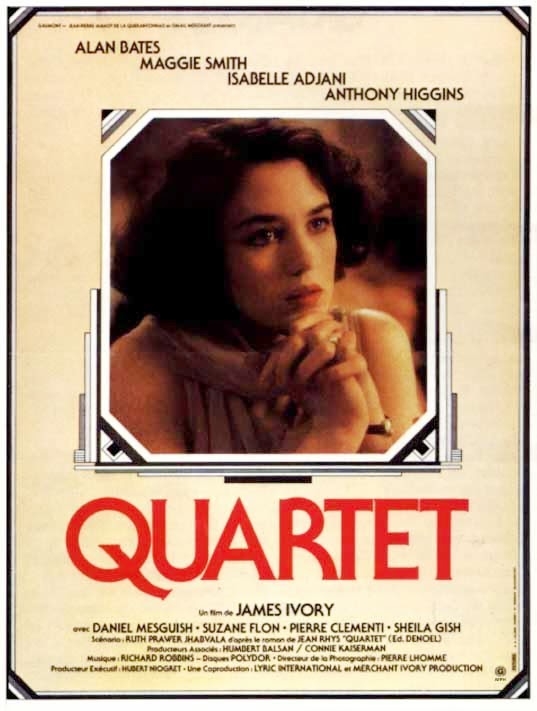






%2B-%2Bregina.jpg)




























